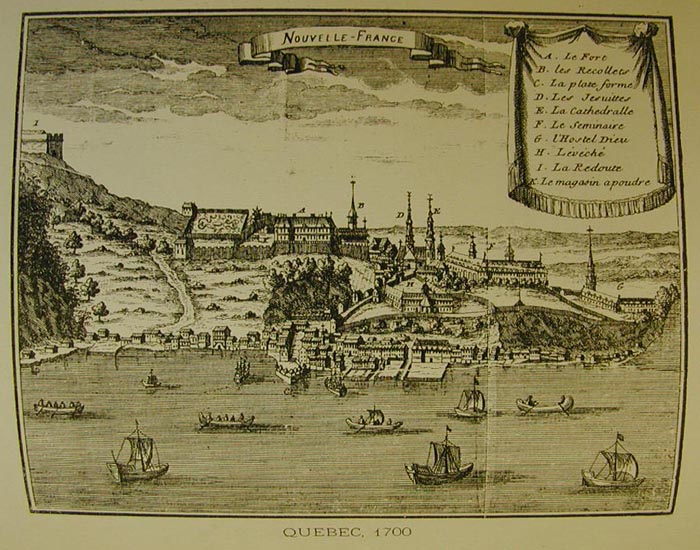Ces jours-ci, les États-Unis d'Amérique sont aux prises avec une des catastrophes naturelles les plus grave de l'histoire avec l'immense marée noire causée par une fuite d'une plateforme de forage de la compagnie British Petroleum. À ce sujet, je vous invite à consulter le dossier du site de la chaîne américaine CNN, en cliquant ici (on en parle aussi largement dans nos médias au Québec). Rien ne me semble comparable au Québec, mais ça ne veut pas dire que le Québec s'en tire avec une note parfaite quand vient le temps de penser à notre gestion des matières à risque.

Source: Image de la US Coast Guard, tiré du site treehugger.com, consultation en ligne, 15 juin 2010.
Il n'y a pas si longtemps, Le site Internet du quotidien Le Soleil parmi d'autres nous apprenait (lundi 3 mai 2010) que le quartier Limoilou avait été le théâtre d'une fuite de gaz toxique, le styrène. Bien que la ville ne soit par étrangère aux fuites de gaz par les temps qui courent (faut-il se rappeler la fuite de benzène dans Saint-Sauveur en 2009), ce genre d'incident, à Québec et au Québec, heureusement assez rare, n'est malheureusement pas une nouveauté. Nous n'avons pas à aller bien loin dans le passé pour nous rappeler un des épisodes les moins glorieux de l'histoire du Québec en matière de gaz toxique, l'incendie des biphényles polychlorés (ou encore polychlorobiphényles), mieux connu sous l'acronyme BPC, de Saint-Basile-le-Grand.

Source: Image de la US Coast Guard, tiré du site treehugger.com, consultation en ligne, 15 juin 2010.
Il n'y a pas si longtemps, Le site Internet du quotidien Le Soleil parmi d'autres nous apprenait (lundi 3 mai 2010) que le quartier Limoilou avait été le théâtre d'une fuite de gaz toxique, le styrène. Bien que la ville ne soit par étrangère aux fuites de gaz par les temps qui courent (faut-il se rappeler la fuite de benzène dans Saint-Sauveur en 2009), ce genre d'incident, à Québec et au Québec, heureusement assez rare, n'est malheureusement pas une nouveauté. Nous n'avons pas à aller bien loin dans le passé pour nous rappeler un des épisodes les moins glorieux de l'histoire du Québec en matière de gaz toxique, l'incendie des biphényles polychlorés (ou encore polychlorobiphényles), mieux connu sous l'acronyme BPC, de Saint-Basile-le-Grand.

Source: Photographie montrant l'épaisse colonne de fumée d'échappant de l'entrepôt en feu, Consultation en ligne, 15 juin 2010.
23 août 1988. 20h40. Au moins trois explosions sont entendues près de l'entrepôt municipal de Saint-Basile-le-Grand (rive-sud de Montréal). Cet entrepôt est utilisé par l'entrepreneur Marc Levy qui y entreposait des BPC. Concrètement, les BPC font référence à plus de 200 substances différentes qui prennent toutes la forme de liquide assez stable et transparent. Ce serait Alain Chapleau, alors employé municipal de St-Baile-le-Grand, un homme qui a été accusé, puis acquitté (et qui aurait, 14 ans après le fait, avoué ses actes) qui aurait mis le feu à l'entrepôt. Le brasier est intense. Les dégâts seront majeurs. Mais les dégâts finiront par être contenus. On confirmera que les cours d'eau touchés pourront être presque entièrement dépollués, les BPC pourront être déplacés, les habitants pourront entrés chez eux vers le 9 septembre 1988.
La contamination sera immense. Bien qu'une firme spécialisée ait pu récupérer presque toutes les eaux usées sur place, c'est plus de 3000 foyers de St-Basile-le-Grand et des villes avoisinantes (St-Bruno, Ste-Julie) qui ont dû être évacués, certains pour trois semaines. Les dégâts ont coûté plusieurs dizaines de millions de dollars et les BPC seront finalement presque tous éliminés de St-Basile 10 ans plus tard alors qu'ils ont pu être transportés de façon sécuritaire vers l'incinérateur de Swan Hill en Alberta ou dans un centre d'enfouissement du Québec, celui de Grandes-Piles en Mauricie. Les terrains sur lesquels se trouvaient l'entrepôt constituent aujourd'hui un espace vert qui ne permet pas de rappeler ce qui s'y est passé.
La contamination sera immense. Bien qu'une firme spécialisée ait pu récupérer presque toutes les eaux usées sur place, c'est plus de 3000 foyers de St-Basile-le-Grand et des villes avoisinantes (St-Bruno, Ste-Julie) qui ont dû être évacués, certains pour trois semaines. Les dégâts ont coûté plusieurs dizaines de millions de dollars et les BPC seront finalement presque tous éliminés de St-Basile 10 ans plus tard alors qu'ils ont pu être transportés de façon sécuritaire vers l'incinérateur de Swan Hill en Alberta ou dans un centre d'enfouissement du Québec, celui de Grandes-Piles en Mauricie. Les terrains sur lesquels se trouvaient l'entrepôt constituent aujourd'hui un espace vert qui ne permet pas de rappeler ce qui s'y est passé.
Documents d'intérêts
Alerte sur Saint-Basile-le-Grand. (reportage télé). Les Archives de Radio-Canada. Société Radio-Canada. Dernière mise à jour : 14 août 2008. Page consultée le 3 mai 2010.